 Prix degressif
Prix degressif





En ce moment, choisissez votre cadeau dans votre panier dès 79€ !
En juillet, la saison apicole entre dans une phase charnière. Après l’intensité du printemps et des premières miellées, les colonies affrontent désormais les contraintes estivales : chaleur, sécheresse et raréfaction des ressources florales dans certaines régions. Pour l’apiculteur, c’est le moment d’observer attentivement l’état de chaque colonie, d’organiser les récoltes de miel d’été et de préparer la suite de la saison sans relâcher la vigilance. La réussite de l’année apicole dépend aussi de la qualité des actions menées ce mois-ci.
Le mois de juillet représente souvent le sommet de l’activité dans la ruche, avant un ralentissement progressif en août. Les colonies sont encore bien peuplées, mais certains signes annoncent la transition :
Cette baisse progressive du dynamisme est naturelle, mais elle impose à l’apiculteur une vigilance accrue sur la santé globale de la colonie, en particulier sur la qualité du couvain et la présence de la reine.
Les possibilités de butinage varient fortement d’une région à l’autre en juillet. Là où les ronces, le châtaignier, le tournesol ou encore la lavande sont présents, les butineuses peuvent encore rapporter de belles quantités de nectar. Ailleurs, c’est parfois la disette florale qui s’installe rapidement.
Plusieurs facteurs influencent la miellée :
Dans ce contexte, l’apiculteur doit adapter ses décisions : pose de hausses supplémentaires, suivi du poids des ruches, ou début de la récolte en cas d’operculation des cadres.
En juillet, les apiculteurs surveillent de près l’état des hausses. La récolte de miel d’été se déclenche lorsque les cadres sont operculés à plus de 80 %, signe que le miel est suffisamment déshydraté pour être conservé sans fermentation. Ce moment varie selon :
La récolte doit être faite en fin de matinée ou en début d'après-midi, lorsqu'une partie des abeilles sont parties butiner. Il est conseillé d’intervenir rapidement après la fin des miellées pour éviter que les abeilles ne consomment ou ne déplacent les réserves.
Lorsque les hausses sont prêtes à être retirées, plusieurs options s’offrent à l’apiculteur :
Avant de stocker les hausses, il est impératif de :
Toutes les hausses récoltées ne sont pas identiques. Certaines contiennent du miel clair (acacia, ronce), d’autres plus foncé (châtaignier, tournesol). Il peut être judicieux de séparer les hausses par type de miel pour produire des variétés monoflorales, si les conditions le permettent.
Un tri rigoureux permet aussi de repérer d’éventuelles anomalies :
En juillet, la chaleur excessive peut perturber la colonie : les abeilles doivent ventiler pour maintenir une température constante dans le nid à couvain (environ 35 °C). Une canicule prolongée mobilise de nombreuses ouvrières à la ventilation et à la recherche d’eau, au détriment du butinage et du développement du couvain.
Le stress hydrique touche aussi les floraisons : certaines fleurs s’ouvrent mais produisent peu ou pas de nectar. Ce manque de ressources peut fragiliser les colonies, surtout celles très populeuses.
Un point d’eau est indispensable à proximité du rucher, idéalement entre 5 et 50 mètres. Pour être efficace, il doit :
Un abreuvoir bien conçu permet de limiter les vols vers des sources inappropriées (piscines, abreuvoirs à bétail…).
Certaines pratiques peuvent aider à soulager les colonies :
En période de fortes chaleurs, l’apiculteur devient un gestionnaire thermique autant qu’un éleveur.
Dans plusieurs régions, la grande miellée se termine courant juillet. La colonie amorce alors une transition : la ponte de la reine diminue, le couvain se réduit, et les réserves doivent progressivement se constituer. L’apiculteur doit identifier la fin de la miellée pour :
Cette étape est stratégique pour maintenir un bon équilibre et préparer une récolte propre.
Le Varroa destructor, parasite redouté, prolifère dès que le couvain commence à diminuer. Pour limiter son impact :
Chaque visite en juillet doit permettre d’affiner son observation. Tenir un carnet de suivi est utile pour :
L’été est une période de transition décisive : bien préparée, elle garantit un automne serein et un hiver sécurisé pour les colonies.
 Prix degressif
Prix degressif





 Prix degressif
Prix degressif





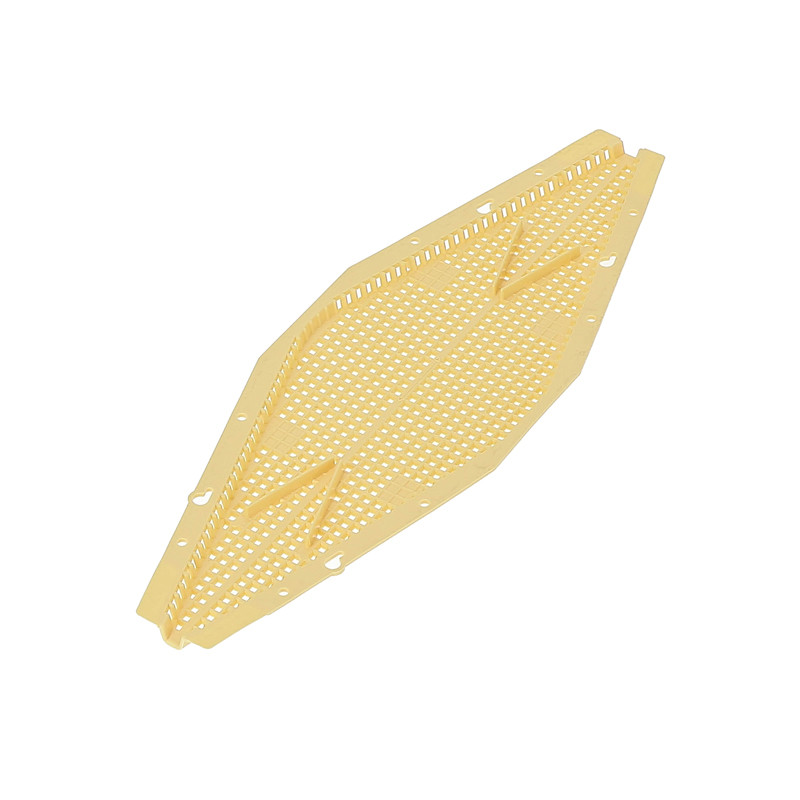 Prix degressif
Prix degressif











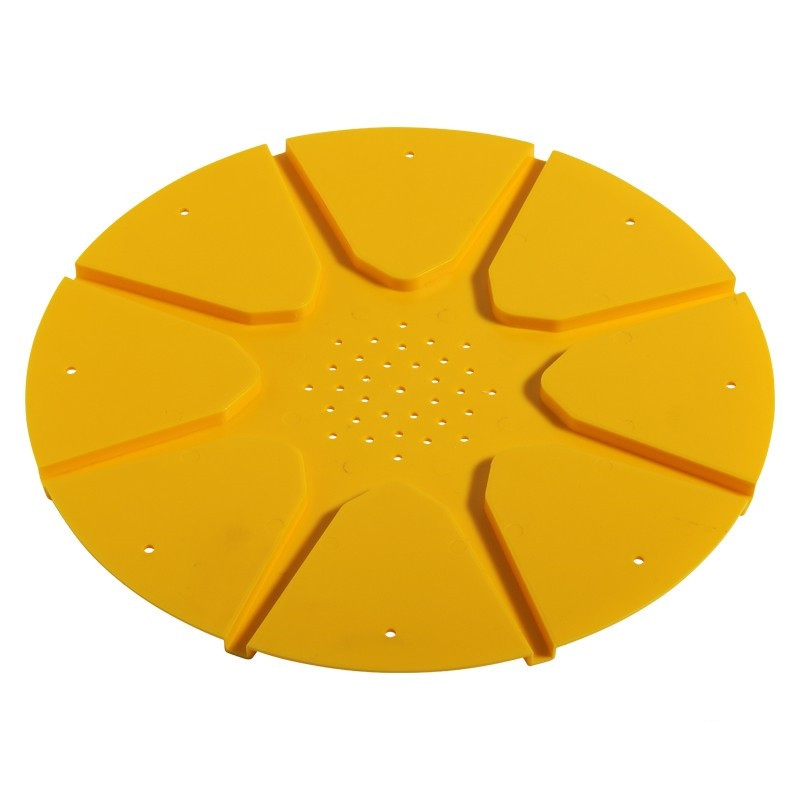 Prix degressif
Prix degressif





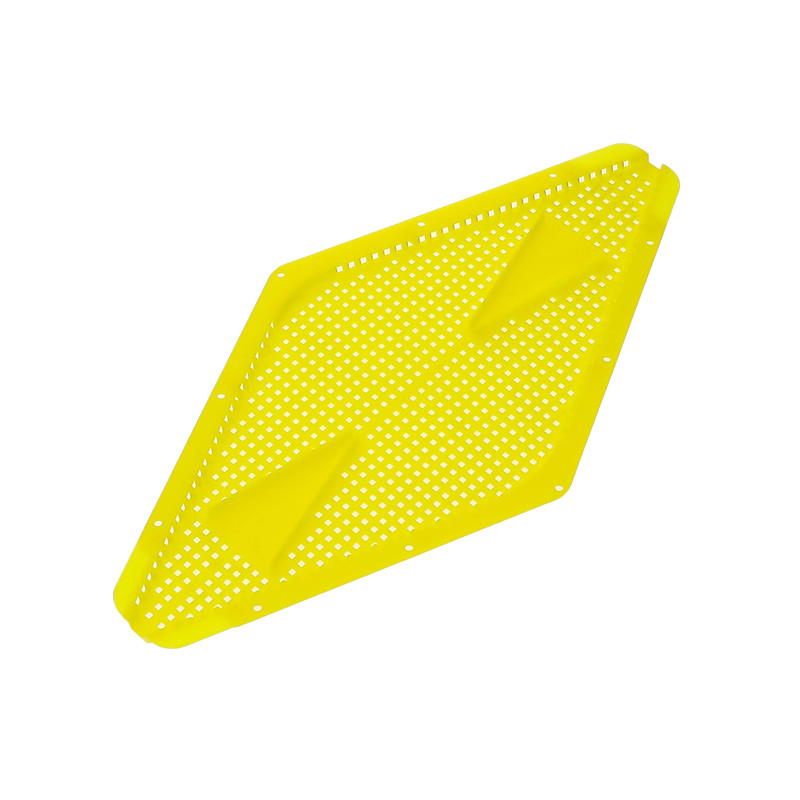 Prix degressif
Prix degressif





En mai, la ruche est en pleine effervescence. Il faut accompagner la croissance, surveiller les réserves et [...]
L’apiculteur ne se contente pas de peupler ses ruches pour enfin récolter du bon miel. Le bon apiculteur sera ce [...]
En Mai, la nature est généreuse pour les abeilles, les fleurs et sources de nourritures abondent. Le développement [...]